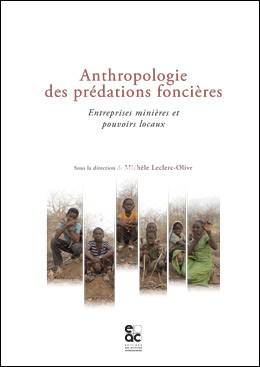
Anthropologie des prédations foncières. Entreprises minières et pouvoirs locaux Sous la direction de Michèle Leclerc-Olive Paris, Édition des archives contemporaines, 2017
En refermant cet ouvrage, relativement bref (143 p.) mais dense et « impactant », on n’est pas seulement enrichi par les matériaux de terrains qui, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, nous font découvrir des sociétés dans leurs lutte pour la survie. Cet ouvrage a un autre mérite, plus didactique, qui est de nous faire prendre conscience du degré de manipulation dont nous faisons l’objet à travers les informations circulant dans les médias et qui nous font prendre « des vessies pour des lanternes » dans le domaine de ce qu’on dénomme communément « l‘extractivisme ».
On peut avoir deux conceptions de l’extractivisme, l’une large et portant sur l’extraction des ressources renouvelables et non renouvelables et l’autre concernant seulement les ressources non renouvelables, en particulier les produits miniers. La première conception est d’emploi fréquent au Brésil et Catherine Aubertin, chercheur de l’IRD, a tenté de lui donner la plus grande place à partir de ses terrains amazoniens. Cette conception a eu son heure de gloire au tournant du XX° siècle avec la collecte du caoutchouc et autres lianes mais n’a actuellement qu’un impact limité au moins économiquement. Par contre, le secteur minier fait la « une » des journaux avec des enjeux financiers et écologiques considérables, ce qui explique les manipulations d’informations que j’évoquais ci-dessus.
Ces manipulations de données et d’informations sont très contemporaines et l’actualité politique et économique, des élections américaines au pompage des dizaines de millions de données personnelles sur Facebook, témoigne de la multiplication des « fake news » et de la capacité des firmes internationales à réorienter à leur profit (donc à leurs profits, qui peuvent être considérables) une présentation euphémisée, épurée des conflits en cause mais en fait cynique, de situations de terrains où elles interviennent.
J’avoue personnellement avoir compris que je pouvais avoir été manipulé en rendant compte ces dernières années de la question de l’orpaillage en Afrique de l’Ouest dans plusieurs travaux de grande qualité anthropologique et politique. En dépit de la « prime à l’altérité » qu’accorde l’anthropologue à ces analyses proches de récits de « Far West » américain, la violence endémique régnant dans ces campements de fortune (au double sens qu’on y cherche la fortune et qu’on y trouve plus souvent la misère, l’exploitation et la mort) primait dans les commentaires que j’en faisais. J’avais observé cette violence sur des placers de l’ouest du Mali dans les années 1990 mais la relation de ces pratiques avec les choix de politique minière des États africains ne m’était pas apparue immédiate.
Or, c’est bien là où se situe l’incroyable connivence entre les États africains (et non africains) et les firmes extractivistes internationales dans des contextes de généralisation du néo-libéralisme, de la financiarisation des activités de production et du boom des terres rares (entre autres).
Dans son introduction générale (p. vii-xviii), et en restituant l’histoire de cette publication, Michèle Leclerc-Olive en explicite les principaux enjeux. Car cette publication est le produit d’un enrichissement d’un programme initial qui avait une priorité plus proprement ethnographique. Puis, ces analyses de terrains ont été bousculées, interpellées et finalement éclairées par une seconde série de monographies confrontées à l’impact des interventions des sociétés minières sur les sociétés locales et la corrosion de leurs systèmes de pouvoirs.
Revisiter des notions de base
Au départ, nous étions quelques collègues ou amis ayant partagé depuis des années des publications et poursuivant une analyse du « pouvoir au village » en Afrique de l’ouest. Ainsi, explicitant ce que j’avais déjà analysé lors d’un Samedi de REGARDS en 2016 sur la polyarchie, je mettais alors l’accent dans ma communication (p. 73-84) sur un biais propre à la présentation coloniale, la conception de la chefferie. Le travestissement du pluralisme juridique et normatif inhérent à l’exercice endogène du pouvoir local de nature originellement « communautaire » n’est pas anecdotique, tant il tranche avec les interprétations anciennes et récentes du supposé despotisme précolonial. Mais il y avait beaucoup plus à considérer. C’est le mérite de jeunes chercheurs de le mettre en évidence.
Trois chercheurs burundais, Aymar Nyenyezi Bisoka, An Ansoms et Emery Mushagalusa Mudinga, se proposent ainsi (p. 85-98) de repenser la notion de « local » à partir de « La transgression de règles dans la gestion foncière au Burundi ». Citons seulement les dernières phrases de leur conclusion : « Elle [la catégorie du local] est non seulement complexifiée par la pluralité des acteurs et des institutions mais aussi par celle des règles et de leurs cadres (…) Cela demande donc de la déconstruire pour aboutir à une épistémologie permettant une compréhension fine des dynamiques d’accès à la terre » (p. 96). Avec Émile Le Bris, j’utilisais déjà en 1986 la métaphore de l’échelle de Jacob pour rendre compte de la multiplicité des dimensions du local[1].
Olivier Leservoisier privilégie l’échelle internationale dans « Mobilisation et initiatives des migrants haalpulaaren face aux enjeux d’accaparements des terres dans la vallée du fleuve Sénégal (Mauritanie, Sénégal) » (p. 1-14). Il y restitue la stratégie de ces migrants principalement aux USA pour mobiliser à l’échelle internationale des réponses aux pratiques d’accaparements qui se multiplient depuis 2008 en bénéficiant jusque maintenant des facilités et des complicités que les firmes et les fonds souverains trouvaient précisément à cette échelle internationale. Exclus du dialogue national mauritanien depuis ce qu’on dénomme pudiquement les « événements tragiques de 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie », que j’avais pu observer alors sur le terrain, ils trouvent à l’échelle internationale et par le web la capacité à peser à nouveau sur l’affectation de leurs terres ancestrales.
La contribution de Sylvie Capitant (p. 29-46) est tout aussi pertinente en mettant en évidence et en renouvelant la notion « d’économie morale » dans la protestation de populations du Burkina Faso « à l’assaut des mines ». Et c’est déjà là où on peut rectifier nos présupposés négatifs à l’égard de l’orpaillage quand elle met en parallèle les notions d’émeute et d’économie morale, son analyse ouvrant à une « meilleure prise en compte de ce désaccord que semblent exprimer les actions populaires directes répétées sur le terrain » (p. 46).
Enfin, c’est la notion de collectif qui est également revisitée par Mohammed Benidir à propos d’une « Mobilisation » à une échelle plus régionale dans « Le cas de la mine d’argent d’Imiter dans le sud-est du Maroc (2011-2015) » (p. 47-60). Citons, là aussi, la dernière phrase : « (…) le défi est de rendre compte simultanément de la surpolitisation des activistes porte-parole de la communauté touchée, de la ‘dépolitisation’ des actions de la société minière, et de ce mode de gouvernance ‘colonial’ des autorités locales, « négativement neutres » qui plait tant aux entreprises extractives » (p. 58). Ces observations peuvent servir de transition avec la deuxième dimension de la publication.
La communication biaisée des sociétés minières et l’ambiguïté des États
Je concentrerai mon commentaire sur trois points :
– L’inventivité de la communication des sociétés minières,
– la confusion des intérêts publics et privés,
– la débandade des élites africaines, à l’âge de la politique du ventre.
a) Pour donner une idée de l’inventivité de « l’agir communicationnel » des sociétés minières, on pourra s’arrêter sur l’expression de « mine durable ». On peut la traiter comme un oxymore puisque la contradiction entre le sens de <mine> comme cadre où une ressource s’extraie et s’épuise et <durable> avec ses connotations du sustainable anglais comme reproductible et pérenne propose de gommer de manière euphémisée l’extraction et l’atteinte à la nature au profit d’une image apaisée d’un futur prometteur. Une variante est « l’exploitation minière durable » qu’explore en tant que véritable escroquerie intellectuelle une traduction de l’anglais d’une étude de Stuart Kirsch « L’industrie minière répond aux critiques » (p. 121-136, avec une bibliographie percutante). Il y a là un très grand professionnalisme de la part d’experts payés à la hauteur des enjeux, colossaux, comme dans les industries pharmaceutiques, car on y retrouve les mêmes processus et les mêmes confusions entre éthique et pratiques, science et connivences financières, grands principes et multiples accommodements entre amis.
b) Une autre remarque peut porter sur la confusion des intérêts publics et privés avec deux questions particulières à appréhender.
– D’une part les politiques minières étatiques sont d’une grande ancienneté et sont liées à un monopole royal qui s’était exercé dès la conquête espagnole au Pérou et en Amérique latine et partout en Europe médiévale. La distinction entre le fonds et le très-fond qu’introduit M. Leclerc-Olive au début de son introduction est centrale car elle permet de distinguer entre la partie superficielle d’un sol qui peut faire l’objet, dira le code civil, d’un « droit de propriété [qui] emporte la propriété du dessus et du dessous » (art. 552) et les ressources profondes, « minières ». Celles-ci seront, dès 1810 en France, strictement contrôlées par la puissance publique au nom d’un principe régalien qui sera introduit en Afrique par les politiques coloniales. Dans son « Capitalisme foncier et démocratie au Pérou » (p. 15-28), Emmanuelle Piccoli rappelle cinq siècles de confrontations autour de l’extraction de l’argent puis de l’or et un contexte de champ de bataille autour des projets contemporains de Cajamarca.
– D’autre part, nos conceptions du public et du privé sont à réviser. Pour ce qui concerne l’Afrique, les conceptions endogènes originelles sont totalement étrangères à ce que l’Europe a prétendu « universaliser ». Au lieu d’être fondées sur un droit de propriété, public ou privé comme en Europe, les ressources foncières ou les gisements minéraux relèvent du principe des Communs[2] où ce sont les multiples utilités de ces ressources qui déterminent autant de services rendus et de régimes de juridicité pour les organiser et les protéger. C’est ce principe qui explique que l’orpailleur a un droit sur la ressource qu’il a découverte « usque ad infernum » disaient les anciens Romains, pour le meilleur et pour le pire. En prenant conscience non seulement de l’occultation de cette logique et des réalités qu’elle organise, mais aussi de la systématisation des destructions qu’autorise cette ignorance, on commence à entrer dans la compréhension de ce que peut représenter l’intervention des sociétés minières. Dans sa contribution « L’or : un bien public ? Autopsie d’une transaction entre une société minière et une communauté villageoise (Mali) » (p. 99-120), Michèle Leclerc-Olive remue le couteau dans la plaie. « Public, une catégorie obsolète ? » s’interroge-t-elle avec raison, en prolongeant nos remises en question de la première partie sur les concepts pertinents. Non seulement on doit traiter l’expression « bien public » comme un autre oxymore, au moins juridiquement, mais on peut aussi se souvenir des origines romaines du publicum, associé à la majestas et à l’auctoritas, dans la construction d’une représentation symbolique visant à protéger le pouvoir du Caesar-empereur dans le contexte des fictions de la démocratie romaine défunte. L’or peut être un bien pour certains et être revendiqué par les élites mais ne peut être associé à celle de bien public : intenable
c) La débandade des élites africaines, à l’âge de la politique du ventre.
J’ai gardé pour la fin l’article le plus passionnant, au titre explicite : « Toronto comme sujet politique. Logique financière et violences sur le site minier de Kolaba (Mali) » dont les auteurs sont Lila Chouli, Alain Deneault et Michèle Leclerc-Olive » (p. 61-72). Le Toronto dont il s’agit ici est la capitale provinciale canadienne siège de la plus importante bourse en matière de capitalisations et échanges miniers. Elle est ici invoquée à la manière d’une capitale politique (Washington, Paris, Berlin, etc.) quand on parle des décisions de ses autorités ou de Wall Street pour les fluctuations monétaires. Après avoir décrit l’origine et la nature du conflit en profitant d’un « état de faiblesse » de l’Etat au Mali depuis 2012, autorisant à stimuler l’éviction des populations par des pratiques de corruption et au nom de la toute-puissance invoquée de « Toronto », les auteurs entrent dans l’analyse des stratégies des sociétés minières. Ces stratégies sont dominées par le jeu combiné d’une division du travail entre deux types d’acteurs d’une part et une financiarisation de l’autre. On découvre donc une division du travail de sape et de domination locale progressive entre deux types de sociétés, canadiennes ici, des sociétés junior et des sociétés major. Les premières sont chargées des reconnaissances sur le terrain et de « l’amorçage de la pompe » en réunissant, légalement ou par corruption, les conditions d’une occupation du site minier. Puis, les investissements ayant été réalisés et les infrastructures d’exploitation mises en place, d’une manière « durable » pour elles, ces « Juniors » transfèrent leurs droits à l’armée lourde des Seniors qui vont exploiter et réaliser les bénéfices les plus exhaustifs en se référant à la loi du contrat, à la législation minière mais aussi à la loi du plus fort. Tout cela est dominé par une logique de financiarisation avec intégration capitalistique des sociétés et jeu sur les fiscalités qui fait que seulement quelques intermédiaires maliens ont pu profiter du « pactole » par le biais des offres de corruption ou de concussion. Malheur aux plus faibles en contexte de néo-libéralisme !
En conclusion, je serai bref. « Dans les petites boites les fines épices » me disait ma grand-mère. Malgré la modestie du volume de cet ouvrage, le lecteur va pouvoir découvrir, à partir de ces notations ou observations introductives, non seulement la possibilité de revoir ses catégories analytiques mais aussi de réinterpréter des processus d’intervention que nous désignons, sans trop y réfléchir, sous le vocable de « développement », mais qui ne sont que de « l’enveloppement » de sociétés locales des Suds au nom de logiques financières qui ne profitent « qu’aux très riches ».
Puisque nous fêtons les cinquante ans de mai 1968 reprenons un de nos slogans de l’époque : « ce n’est qu’un début, continuons le combat » pour plus de justice et de solidarité, dans la perspective interculturelle qui nous réunit.
[1] B. Crousse, E. Le Bris, E. Le Roy, Espaces disputés en Afrique noire, pratiques foncières locales, Paris, Karthala, 1986, p. 339-347.
[2] Etienne Le Roy, « Des Communs <à double révolution> », Droit et Société, Études, vol. 94, 2016, p. 603-624.
Poster un Commentaire