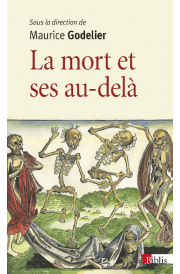
01/07/2016 : Etienne Le Roy : Sous la direction de Maurice Godelier : La mort et ses au-delà Paris, CNRS Éditions, Bibliothèque de l’Anthropologie, 2014, 410 pages,
Dans la grande tradition de l’anthropologie sociale, Maurice Godelier nous offre une approche synthétique des représentations relatives à la mort visant, selon le pari jadis formulé par Claude Lévi-Strauss dans son Anthropologie structurale (Paris, Plon, 1958), « une connaissance globale de l’homme embrassant son sujet dans toute son extension historique et géographique (…) et tendant à des conclusions, positives ou négatives, mais valables pour toutes les sociétés humaines, depuis la grande ville moderne jusqu’à la plus petite tribu mélanésienne » (p. 388).
Si le continent africain et ses multiples sociétés, cultures et expériences de la mort sont inexplicablement absents, si les données préhistoriques ne sont que superficiellement mentionnées en dépit des ouvertures réalisées jadis par André Leroi-Gourhan à partir de l’art pariétal, quatorze monographies, chacune d’une trentaine de pages, nous proposent une explication des cohérences et des logiques multiples dans les pratiques mortuaires, en associant à une anthropologie religieuse, à la sémiologie et à l’iconologie une démarche ethnologique au plus près des données écrites ou orales. Sont ainsi abordés successivement la Grèce et la Rome antiques, les mondes juif et musulman, le Moyen-Âge chrétien, les expériences indienne et chinoise puis sept ethnographies nous faisant découvrir les Thaïs bouddhistes, les Ouzbeks, les Tikuna et Miraña d’Amazonie, les Sulka et Baruya de Mélanésie où Maurice Godelier avait élaboré sa « Production des Grands hommes » (Paris, Fayard, 1982) et enfin les Ngaatjatjarra, Aborigènes australiens.
Les contraintes de place dans Mondes et cultures n’autorisent pas à rendre justice aux divers contributeurs ni même à détailler le contenu de chacune des monographies. Disons simplement que nos collègues ont choisi un mode pédagogique qui permet d’entrer dans les spécificités des représentations du monde de chacune de ces cultures dans leurs incidences sur les conceptions de l’au-delà. J’en relèverai quelques-unes en fin de texte pour concentrer mon propos sur les conclusions anthropologiques que tire Maurice Godelier dans son introduction (p. 9-49).
L’idée fondamentale qu’illustre M. Godelier est que la mort s’oppose à la naissance, non à la vie qui, elle, doit continuer son long cours selon des modalités que huit invariants sur le mort puis quatre variations permettent d’éclairer.
Huit invariants formant paradigme
1° « Naissance et mort, tout en s’opposant, sont liées l’une à l’autre, forment système ». (p. 40)
2° De ce fait, si la naissance est la conjonction de plusieurs composantes de l’individu, la mort en est la disjonction.
3° Parmi ces éléments disjoints lors du décès, « il y en a toujours un ou plusieurs qui survivent à la mort et vont commencer alors une nouvelle forme d’existence ». (idem)
4° Cet élément est généralement appelé âme ou esprit. Il est « le principe de vie, un principe vital » (ibidem).
5° « Du fait que la mort n’est pas conçue comme la fin définitive de l’existence d’un individu, ses proches doivent avoir (…) une conduite socialement prescrite ». (idem).
6° Le cadavre est séparé du monde des vivants après une période plus ou moins longue, marquée par « des rites funéraires qui précèdent, accompagnent et suivent les funérailles ». (p. 41)
7° Les proches, par la parenté ou la participation aux rituels, vont prendre le deuil comme manifestation « de ce que signifie pour eux cette disparition ». (idem)
8° Toutes les sociétés semblent partager l’idée d’un séjour habituel des morts où ils se rendent après une période plus ou moins longue et sous la condition d’un « accomplissement rigoureux des rites pour les vivants et pour les morts. Si les rites ne sont pas respectés, les vivants prennent le risque de transformer des morts en des <mauvais> morts qui reviendront les hanter et leur nuire ». (p. 41)
Quatre variations
- a) « Est-ce que le mort va ressusciter après sa mort ? » (p. 42)
- b) « Si le mort ressuscite est-ce dans le même corps, dans le corps d’un(e) de ses descendant(e)s (…) ou se réincarne-t-il dans d’autres être humains ou d’autres formes d’existants (…) » comme l’illustrent les monographies sur l’Indouisme et sur le Bouddhisme. (p. 42)
- c) Le mort sera-t-il jugé après sa mort, et par qui ?
- d) « À l’issue de son jugement (…) le mort est-il destiné à vivre éternellement en enfer ou au paradis ou doit-il recommencer une nouvelle vie pout accroître ses mérites (…) ? » (p. 42). Ici, Maurice Godelier différencie les religions de la délivrance qui, comme le Bouddhisme, pensent que le mort disparaît « dans le Grand Tout de l’univers » et les religions du salut, le Christianisme et l’Islam où « l’individu se retrouve éternellement seul face à Dieu dans l’attente d’être appelé à siéger auprès de lui au paradis ou d’être précipité à tout jamais en enfer ». (p. 43)
Mais, nous dit finalement l’auteur, « (l)es mondes imaginaires des religions ne sont pas le produit d’une Humanité encore dans l’Enfance » et leurs utopies sont « de celles qui ont obligé les hommes à s’inventer ». (p.49)
Et quelques illustrations des ressemblances et différences
Il y a des homologies étonnantes entre les conceptions grecque et chinoise qu’avait déjà perçu Jean-Pierre Vernant. « La survie peut être considérée sous ses deux aspects : comme exemple subsistant dans la mémoire des vivants ou comme esprit égaré dans un autre monde (…) (p. 206).
La mort n’a pas de représentation dans la religion romaine où elle apparaît comme une abstraction vague et imprécise (p. 110).
Dans le monde juif, la mort est « l’entrée dans un commencement (…) L’éternité n’est pas un perpétuel futur, mais une perpétuelle présence ». (p. 119) Et ainsi, aussi paradoxal que cela paraissent malgré les époques tragiques et les persécutions, les cimetières « ont évité toute représentation macabre [même si les sépultures portent] le souvenir gravé des communautés assassinées et la trace indélébile d’une forme aussi pérenne qu’imperceptible de judéité » (p. 156).
La contribution de Christian Jambert sur l’Islam est d’autant plus précieuse, en ces temps troublés, qu’il pose que l’enjeu est ici plus de valider le rôle des intercesseurs, « la foi dans la mission prophétique des envoyés », que d’imposer un cadre unique de croyances. Il souligne aussi que le croyant est serviteur (p. 163) et que le djihad est « le modèle de l’anéantissement de soi (fanâ’) », une des étapes de l’expérience mystique qui « fait sortir l’esprit du monde inférieur, et même de l’ensemble des mondes, pour la faire se consumer en présence de divine » (p. 175-176).
De l’approche indienne, je retiens, en conclusion, « une expérience existentielle partagée et toujours cohérente d’une phénoménologie très ancienne dont les amnésies sélectives (…) conduisent à affirmer qu’elle ne serait parvenue jusqu’à nous que pour nous assurer encore de toute sa pertinence ontologique ». (p. 246) Et cette autre proposition : la mort « est le nœud qui relie, le juge qui arbitre, réconcilie mais ne tranche pas ». (p. 247)
Parlant de la place et du nombre des âmes (khwan) dans la vie des humains, B. Formoso note que « la plupart des Thaïs convertis à la religion de l’Illuminé s’accordent sur le chiffre de 32 qui est le symbole de la totalité parfaite dans la pensée bouddhique. » Ces âmes « en font plus spécifiquement les facteurs de vie et d’équilibre des organes et parties du corps ». Leur cohésion est problématique et « la mort, quant à elle, se concrétise par leur dispersion irrémédiable ». (p. 276)
La portée de la description du cas ouzbek est tout autre puisqu’il illustre comment un autocrate, Islam Karimov, a réussi en quelques années, en mobilisant la philosophie soufi et par simple souci de modernisme touristique, à détruire une tradition que la période soviétique et la guerre voisine en Afghanistan n’avaient pu déstabiliser.
Il est ensuite question de chamanes et de messianismes chez les Tikuna, de caciques et d’anthropophagie chez les Miraña, des paramètres qu’on retrouve chez les Baruya dont la société est construite sur la base des initiations. Chez leurs « voisins » Sulka de Papouasie-Nouvelle Guinée, on retrouve actualisée cette proposition générale : « tandis que l’immortalité constituait la condition première de l’humanité, la mort, qui était évitable, ne fit que sanctionner une occasion manquée ». (p. 367) Les Sulka illustrent aussi cette propension d’une « transformation de la douleur en colère [qui] permet de rediriger l’agression en neutralisant la violence émotionnelle subie au moyen d’une violence infligée » (p. 375), sans oublier le rôle du rire et « son pouvoir tranformateur » (p. 380).
Enfin, pour le lecteur qui n’aurait le temps que de découvrir une seule de ces monographies, nous suggérons de partager avec nous la découverte du texte de Laurent Doucet, La mort chez les Ngaatjatjarra, groupe aborigène vivant en Australie dans le désert de l’ouest dont l’environnement est réputé « le plus rude jamais habité par l’homme avant la révolution industrielle ». (p. 387) Il y découvrira comment se construit la personne lors de la conception de l’embryon puis se séparent ses éléments lors du décès, pourquoi une mort n’est jamais « naturelle » et comment, par ses multiples affiliations et initiations, l’individu accède à une pluralité de droits sur les lieux et les ressources en faisant l’économie de la notion de propriété. Et comment, enfin, la colonisation interne des Australiens est venue bouleverser ces représentations sans finalement provoquer l’ethnocide recherché. Un texte tout à l’honneur de la monographie ethnologique.
Étienne Le Roy
Poster un Commentaire